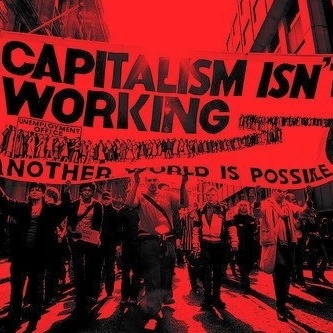L’époque n’est plus où l’on pouvait parler d’un mouvement féministe au singulier. Tel qu’il était né en Europe, à la fin du dix-huitième siècle, quand des écrivaines comme Mary Wollstonecraft ont commencé à engager la lutte pour les droits des femmes, ce mouvement était lié à l’affirmation de l’idée démocratique et à l’émergence de ce que l’anthropologue Louis Dumont avait appelé l’homo aequalis.
Les hommes étaient déclarés libres et égaux en droit, mais les femmes (de même que les colonisés et les esclaves) étaient inégales en vertu de leur nature. Ce combat s’est poursuivi, élargi, organisé et même mondialisé. La conférence de Pékin organisée par l’ONU en 1995 a marqué l’apparition d’un discours officiel sur les droits des femmes parmi lesquels celui de contrôler leur propre existence. On y utilise aussi un nouveau concept, celui de « genre », qui indique que les rapports entre les sexes ne dérivent pas de la biologie mais résultent d’une construction sociale, et qui incite donc à réévaluer les relations hommes-femmes.
Derrière cette convergence de façade, ont cependant surgi des interrogations qui, objets de débats théoriques, sont très vite devenues des questions politiques. Le discours des organisations internationales prenait pour acquis que toutes les femmes étaient également dominées et qu’elles avaient donc des intérêts communs. Cependant, aux États-Unis, en Afrique, en Inde, en Iran, en Malaisie, se développaient divers mouvements relevant du black feminism, du féminisme islamique et plus généralement du courant postcolonial, qui contestaient ce point de vue. Ils ont mis en évidence les différences et les divisions existant entre les femmes, et la nécessité de prendre en compte la classe sociale, l’ethnicité, l’arrière-plan culturel et religieux, le passé colonial et ce qui en persiste et qui pèse lourdement sur le regard porté sur les femmes.
Les femmes des pays en direction desquels se menaient les entreprises coloniales ont souvent été décrites comme des victimes passives de leurs hommes, de leur société, de leur religion. Les colonisateurs se présentaient alors comme des sauveurs et des libérateurs alors même qu’ils faisaient subir les violences parfois les plus extrêmes aux hommes et aux femmes des régions sur lesquels ils souhaitaient établir leur domination. Ce récit tendait à justifier l’entreprise coloniale et à affirmer la suprématie culturelle des pays du Nord. Il correspond à une vision orientaliste dont on constate la persistance dès lors qu’il est question des femmes musulmanes. C’est lui que l’on retrouve de façon récurrente dans ce que l’on peut appeler le féminisme majoritaire contemporain qui n’a pas su pousser assez loin son exigence de considérer les femmes comme plurielles et diverses.
Le biais orientaliste consiste, en effet à faire disparaître toute la dimension sociale et historique de l’étude des rapports de genre. On enferme l’islam et les musulmans dans une essence et une altérité radicales hors de la durée historique et des divisions sociales et sociétales, et on se rallie à la vision commune de femmes asservies aux hommes du fait de ce que l’on désigne comme l’ « Islam » et écrasées sous le poids de traditions patriarcales, en se focalisant sur les codes vestimentaires, en particulier sur le port du foulard. Cette vision stéréotypée est contredite à la fois par les travaux menés par des historiennes qui ont montré que les femmes du monde arabe et musulman ont été présentes dans les processus de transformation de leurs sociétés et de leurs propres conditions de vie, dès le début du dix-neuvième siècle et par les événements récents.
Les « printemps arabes » et, auparavant, le mouvement vert en Iran, ont fait apparaître sur les écrans de télévision les images de musulmanes, voilées et non-voilées, occupant les rues, et affrontant police et armée. Ces images qui faisaient voler en éclats les stéréotypes, étaient celles d’un double défi : défi porté au regard « occidental », défi à l’autoritarisme. Ce même défi est porté par les féminismes islamiques. Ces mouvements singuliers et pluriels, se développent depuis la fin des années 1990 dans de nombreux pays, y compris dans les pays occidentaux. Ils s’inscrivent dans une logique qui est celle à la fois d’un « retour à l’islam » par le port – éventuel – du voile et la réactivation des rituels, mais surtout par la relecture et la réinterprétation des textes sacrés et l’affirmation de l’égalité entre les hommes et les femmes.
Comme les féministes chrétiennes ou juives, les féministes islamiques inventent une voie vers l’égalité des hommes et des femmes en harmonie avec leur foi. Leur positionnement est fondamentalement politique, puisqu’elles mettent en cause de façon radicale l’autorité masculine, le patriarcat, et donc toutes les formes de théocraties qui imposent de façon dictatoriale des lois aux femmes (et aux hommes) en prétendant s’inspirer de la parole divine. La mouvance du féminisme islamique, dans sa complexité et à travers ses différents courants, n’est certes pas majoritaire. Mais elle prend de l’ampleur et de la visibilité, et en articulant de façon tout à fait nouvelle la relation entre Orient et Occident, en établissant des ponts et des passerelles, de l’Asie à l’Amérique en passant par l’Europe et le continent africain, et en tissant de nouvelles combinatoires, elle montre la pauvreté de la théorie du choc des civilisations. On peut y voir une manifestation de la manière dont Frantz Fanon définissait l’universalité, quand il écrivait qu’elle « réside dans cette décision de prise en charge du relativisme réciproque de cultures différentes une fois exclu irréversiblement le statut colonial. »