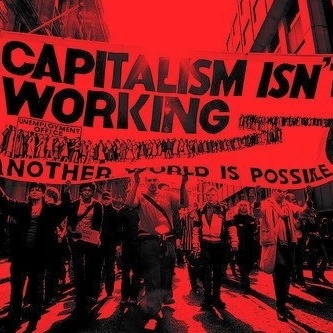Introduction
Au sein du Forum social mondial (FSM), l’ancien et le nouveau s’entrechoquent constamment. Le FSM, en tant qu’utopie et qu’épistémologie, est quelque chose de nouveau. Comme phénomène politique, sa nouveauté coexiste avec les traditions de la pensée de gauche ou, plus généralement, avec les traditions de la pensée contre-hégémonique, dans leurs versions occidentales ou non-occidentales.
Il est généralement admis que la nouveauté du FSM réside dans son approche inclusive et sa portée globale, l’inexistence de dirigeants et d’organisation hiérarchique, l’importance accordée aux réseaux du cyberespace, l’idéal de démocratie participative et sa flexibilité et son désir de procéder par expérimentations. Le FSM est, sans aucun doute, le premier large mouvement international progressiste qui fait suite à l’offensive réactionnaire (backlash) néolibérale du début des années 1980. Son avenir est celui d’un espoir : un autre monde est possible comme alternative à la pensée unique. Un tel avenir reste totalement inconnu, sur lequel nous ne pouvons que spéculer. Il dépend des organisations et mouvements qui font partie du FSM en même temps que des métamorphoses de la globalisation néolibérale. Il faut noter que ces dernières années, le mouvement de globalisation néolibérale a acquis un élément fortement belliqueux, centré sur la guerre néocoloniale et la sécurité ; cela affectera évidemment l’évolution du FSM. Néanmoins, je crois que le défi majeur, à long terme, du FSM va bien plus loin que les stratégies et tactiques de l’action politique et qu’il est la conséquence de sa nouveauté. Nous pouvons le formuler ainsi : en l’absence d’un principe général ou d’un critère capable de fournir unité et structure à l’immense variété d’organisations politiques, de luttes et de cultures qui se rejoignent dans le FSM, quelle est sa capacité à transformer la gigantesque énergie générée en son sein en de nouvelles actions collectives contre-hégémoniques ?
De la théorie générale au travail de traduction
La théorie politique de la modernité occidentale, dans sa version libérale ou marxiste, a construit l’unité de l’action à partir de l’unité de l’agent. Selon cette conception, la cohérence et le sens du changement social ont toujours reposé sur la capacité de l’acteur central du changement, que ce soit la bourgeoisie ou les classes laborieuses, à représenter la totalité dont découlent le sens et la cohérence. De cette capacité de représentation proviennent le besoin d’une théorie générale du changement social ainsi que les opérations qui y concourent.
L’utopie et l’épistémologie qui sous-tendent le FSM se situent aux antipodes d’une telle théorie. L’extraordinaire énergie d’attraction et d’agrégation révélée par le FSM résulte précisément du refus de l’idée d’une théorie générale. La diversité qu’il accueille est libérée de la peur d’être cannibalisé par de faux universalismes ou de fausses stratégies uniques proposées par quelque théorie générale. Le FSM souscrit à l’idée que le monde est une totalité inépuisable, qui contient de nombreuses totalités, toutes partielles. Aussi n’y a-t-il aucun sens à essayer de saisir le monde à l’aide d’une seule théorie générale, car cela supposerait que cette totalité donnée est mono-culturelle et ses parties homogènes.
L’époque dans laquelle nous vivons, dont le passé récent fut dominé par l’idée d’une théorie générale, est peut-être une époque de transition qui devrait être définie de la façon suivante : nous n’avons pas besoin d’une théorie générale, mais nous avons encore besoin d’une théorie générale de l’impossibilité d’une théorie générale. Nous avons besoin, à tout prix, d’un universalisme négatif.
Quelle est l’alternative à une théorie générale ? Selon moi, cette alternative, c’est le travail de traduction. La traduction est une procédure qui facilite l’intelligibilité mutuelle entre des expériences du monde, les rend valides et possibles, comme le montrent la sociologie des absences et la sociologie des émergences, sans compromettre leur identité et leur autonomie, ou pour le dire autrement, sans les réduire à des entités homogènes.
Le FSM est témoin de la grande multiplicité des nombreuses pratiques sociales contre-hégémoniques qui ont lieu de par le monde. Sa force résulte de ce qu’il a correspondu avec l’expression de l’aspiration des différents mouvements sociaux et ONG à s’agréger et à s’articuler entre eux, et l’a rendu possible alors que cette aspiration était restée jusque-là latente. Les mouvements et les ONG se constituent autour d’un nombre plus ou moins réduit d’objectifs, créent leurs propres formes et styles de résistance et se spécialisent dans un certain genre de pratiques et de discours qui les distinguent les uns des autres. De ce fait, leurs identités se créent à partir de ce qui les sépare des autres. Le mouvement féministe se considère très différent du mouvement ouvrier et vice versa ; ils se distinguent tous les deux du mouvement indigène et du mouvement écologiste, et ainsi de suite. Toutes ces distinctions et autres séparations se sont en fait traduites en différentes pratiques, voire en contradictions qui ont contribué à ce que les mouvements se déchirent, à nourrir les rivalités et le conflit entre factions. De là proviennent la fragmentation et l’atomisation qui sont le côté obscur de la diversité et de la multiplicité.
Récemment, les mouvements et les ONG ont largement reconnu ce côté obscur de leurs relations. Nonobstant, la vérité est qu’aucun d’entre eux n’a la capacité ou la crédibilité nécessaire pour s’y confronter individuellement, car en s’y essayant, il courrait le risque d’être victime d’une situation à laquelle il cherche à remédier. Ainsi s’expliquerait l’extraordinaire pas fait par le FSM, même s’il faut admettre que le processus d’agrégation et d’articulation rendu possible par le FSM est de basse intensité. Les objectifs sont limités, car très souvent circonscrits au savoir commun ou, tout au plus, à reconnaître les différences et à les expliciter pour mieux les connaître. Dans de telles circonstances, l’action collective ne peut être que limitée.
Nous pensons que le défi que doit maintenant relever la mondialisation contre-hégémonique peut être ainsi compris : les formes d’agrégation et d’articulation rendues possible par le FSM ont suffi pour atteindre les objectifs d’une phase qui va peut-être prendre fin à présent. Approfondir les objectifs du FSM lors d’une nouvelle phase requiert des formes d’agrégation et d’articulation d’une plus forte intensité. Un tel processus comprend l’articulation des luttes et des résistances, ainsi que la promotion d’alternatives globales et consistantes. Ces articulations présupposent que des combinaisons entre les différents mouvements sociaux et ONG soient trouvées alors qu’elles remettent profondément en question leur identité et leur autonomie telles qu’elles ont été jusqu’à présent pensées. Si le projet est de promouvoir des pratiques contre-hégémoniques qui réunissent les mouvements écologiste, pacifiste, indigène, féministe, ouvrier, etc. de façon horizontale et dans le respect des identités de chacun des mouvements, un énorme effort de reconnaissance mutuelle, de dialogue et de débat va être nécessaire pour mener à bien cette tâche.
C’est la seule façon d’identifier plus rigoureusement ce qui divise ou unit les mouvements, pour mettre à jour les articulations entre pratiques et savoirs qui reposent sur ce qui fait unité et non division. Cette opération requiert un ample exercice de traduction qui élargisse les zones d’intelligibilité réciproque sans détruire les identités des partenaires en traduction. Il s’agit de créer, pour chaque mouvement et chaque ONG, pour chaque pratique et chaque stratégie, pour chaque discours et chaque savoir, une zone de contact qui les rende plus poreux et donc plus perméables aux autres ONG, pratiques, stratégies, discours et savoirs. L’exercice de traduction vise à identifier et à renforcer ce qui est commun dans la diversité du courant contre-hégémonique. Il est néanmoins hors de question de supprimer ce qui crée divergence. Le but est de remplacer la « différence geôlière » par la « différence hospitalière ». Grâce au travail de traduction, la diversité est célébrée, non plus comme facteur de fragmentation et d’isolationnisme, mais bien comme condition du partage et de la solidarité.
Le travail de traduction concerne à la fois les savoirs et les actions (visées stratégiques, modes d’organisation, styles de lutte et d’agency [1][1]Définition : Terme utilisé en sociologie pour exprimer une…). Bien évidemment, savoirs et actions sont inséparables dans la pratique des mouvements. Toutefois, pour les besoins de la traduction, il est important de distinguer les zones de contact où les interactions ont une plus grande incidence sur les savoirs de celles où les interactions portent principalement sur les actions.
J’expose, dans la suite de cet article, quelques illustrations du travail de traduction.
Traduction des savoirs
La traduction des savoirs est un travail d’interprétation entre deux cultures ou plus – celles auxquelles appartiennent les différents mouvements et organisations dans la zone de contact – pour identifier les intérêts et les aspirations qu’ils partagent et les réponses que chacun d’entre eux y apportent. Par exemple, l’attachement et l’aspiration à la dignité humaine semblent être présents dans différentes cultures, même si sous des formes différentes. Dans la culture occidentale, l’idée de dignité humaine s’exprime aujourd’hui par le concept des droits de l’Homme. Si nous regardons les milliers d’organisations et de mouvements qui se rassemblent au FSM, nous observons qu’un grand nombre d’entre eux ne formulent pas leurs préoccupations en termes de droits de l’Homme, et bien au contraire, nombreux sont ceux qui peuvent adopter une position hostile à l’égard de l’idée de droits de l’Homme. Cela signifie-t-il que ces mouvements n’ont rien à faire de la dignité humaine ? Ou plutôt qu’ils formulent leur souci pour la dignité humaine avec d’autres concepts ? Je pense que cette dernière option est la bonne et c’est pourquoi j’ai proposé une traduction du souci pour la dignité humaine par le concept occidental de droits de l’Homme, le concept islamique d’umma (communauté) et le concept hindou de dharma (harmonie cosmique impliquant les humains ainsi que tous les autres êtres).
Dans ce cas, le travail de traduction va mettre en lumière les imperfections et les faiblesses réciproques de chacune des conceptions de la dignité humaine, en la mettant en regard avec les autres. Un espace s’ouvre alors au sein de la zone de contact pour le dialogue, le savoir et la compréhension réciproques et pour identifier, par-delà les différences conceptuelles et terminologiques, les bases communes sur lesquelles des combinaisons pratiques en vue de l’action peuvent émerger. Quelques exemples vont rendre plus clair ce que je veux dire. Si l’on se place dans la perspective du dharma, les droits de l’Homme sont incomplets dans la mesure où ils échouent à établir un lien entre la partie (l’individu) et le tout (la réalité cosmique), et même plus durement, dans le fait qu’ils se concentrent sur ce qui est pure conséquence, sur les droits, plutôt que sur l’impératif primordial, le devoir des individus à trouver leur place dans l’ordre de la société, et dans celui du cosmos tout entier [2][2]J’analyse plus en détail les relations entre droits de l’Homme…. La conception occidentale des droits de l’Homme, considérée depuis la perspective du dharma et aussi de la umma, est fragilisée par une symétrie, très simpliste et mécaniciste, entre droits et devoirs. Elle n’accorde des droits qu’à ceux auxquels elle peut imputer des devoirs. Ceci explique pourquoi, dans la conception occidentale des droits de l’Homme, la Nature n’a aucun droit : car on ne peut lui imputer aucun devoir. Pour la même raison, il est impossible d’accorder des droits aux générations futures : elles n’ont aucun droit, car elles n’ont aucun devoir.
Par ailleurs, le dharma est lui aussi incomplet, si on le considère depuis la perspective des droits de l’Homme, à cause de son penchant prononcé en faveur de l’harmonie du statu quo social et religieux, occultant de ce fait les injustices et négligeant totalement la valeur du conflit comme voie possible vers une plus grande harmonie. De plus, le dharma ne se soucie guère des principes de l’ordre démocratique, de la liberté et de l’autonomie individuelles et il néglige le fait que, sans droits primordiaux, l’individu est une entité bien trop fragile pour ne pas être complètement régi par les puissantes institutions économiques et politiques. De surcroît, le dharma a tendance à oublier que la souffrance humaine possède une dimension irréductiblement individuelle : les sociétés ne souffrent pas, les individus si.
À un autre niveau conceptuel, le même travail de traduction peut être entrepris entre le concept des droits de l’Homme et le concept d’umma dans la culture islamique. Les passages du Coran dans lesquels apparaît le mot umma sont si variés que son sens ne peut être défini de manière rigide. Une chose est sûre pour le moins : il se réfère toujours aux corps ethnique, linguistique et religieux des personnes qui sont les objets du plan de salut divin. Alors que progressait l’activité prophétique de Mahomet, les fondations religieuses de l’umma sont devenues de plus en plus apparentes et par conséquent, l’ummades Arabes s’est transformée en umma des Musulmans. Dans la perspective de l’umma, l’incomplétude des droits de l’Homme individuels repose sur l’impossibilité de fonder les liens collectifs, devoirs et solidarités, sans lesquels aucune société ne peut survivre et encore moins s’épanouir. En cela réside la difficulté d’accepter dans la conception occidentale des droits de l’Homme les droits collectifs des groupes sociaux et des peuples, qu’il s’agisse de minorités ethniques, des femmes ou des peuples indigènes. Inversement, depuis la perspective des droits de l’Homme individuels, l’umma surestime les devoirs au détriment des droits et, pour cette raison, est inséparable d’une disposition à fermer les yeux sur des inégalités autrement exécrables, comme dans le cas de l’inégalité entre hommes et femmes, ou entre Musulmans et non-Musulmans.
La reconnaissance par les différentes cultures de leur incomplétude et de leur faiblesse réciproques est une des conditions sine qua non du dialogue interculturel. Le travail de traduction se construit à la fois sur l’identification locale de l’incomplétude et de la faiblesse et sur son intelligibilité « translocale ». Dans le champ des droits de l’Homme et de la dignité humaine, la mobilisation collective en faveur des revendications émancipatrices dont ils sont potentiellement porteurs n’est possible que si, dans le contexte culturel local, les personnes s’approprient ces revendications. L’appropriation, dans ce sens, ne peut être obtenue par cannibalisation culturelle. Elle exige un dialogue interculturel au moyen du travail de traduction.
Au regard des caractéristiques politiques et culturelles des organisations et des mouvements présents au FSM, bien d’autres exercices de traduction sont nécessaires. Je mentionne l’un d’entre eux sans entrer dans les détails de la traduction. Il se concentre sur la préoccupation pour la vie productive telle qu’exprimée par les conceptions capitalistes modernes du développement et par la conception gandhienne de swadeshi. Les conceptions de la vie productive issues du développement capitaliste ont été reproduites par la science économique conventionnelle et sont souvent implicitement ou explicitement acceptées par les mouvements sociaux et les ONG, particulièrement au Nord. Ces conceptions sont fondées sur l’idée d’une croissance infinie que l’on atteint en assujettissant progressivement pratiques et savoirs à la logique mercantile. Le swadeshi, au contraire, est fondé sur l’idée de durabilité et de réciprocité et Gandhi, en 1956, l’a défini comme suit :
« Le swadeshi est cet esprit en nous qui nous restreint à utiliser et à servir ce qui nous entoure directement, à l’exclusion du plus lointain. Ainsi en est-il pour la religion, où pour remplir les exigences de cette définition, je dois me restreindre à ma religion ancestrale… Si je la trouve défectueuse, je dois la servir en la purgeant de ses défauts. Dans le champ de la politique, je dois tirer parti des institutions indigènes et les servir en les guérissant de leurs défauts avérés. Dans celui de l’économie, je ne dois utiliser que des choses produites par mes voisins immédiats et servir ces industries en les rendant efficaces et complètes là où on peut en vouloir [3][3]Gandhi, The Empathic Civilization: The Race to Global…. »Cette brève description du swadeshi et le poids qu’il revêt parmi les ONG et les mouvements d’Asie du Sud, comme on a pu l’observer lors du FSM de Mumbai, montrent combien le travail de traduction peut être important pour créer les opportunités de mise en place des coalitions entre ONG et mouvements du Nord et du Sud, de l’Est et de l’Ouest, engagés dans le champ du développement et de la production.
Le travail de traduction des savoirs part de l’idée que toutes les cultures sont incomplètes et que par conséquent, elles peuvent être enrichies par le dialogue et la confrontation avec d’autres cultures. Selon moi, le FSM a accordé à cette idée une nouvelle centralité et une plus grande urgence. Reconnaître la relativité des cultures n’entraîne pas l’adoption du relativisme comme position culturelle (l’idée que toutes les cultures sont également valides et qu’aucun jugement ne peut leur être transmis depuis la perspective d’une autre culture). Cela implique par contre de concevoir l’universalisme comme une particularité de l’Occident, dont l’idée de suprématie ne réside pas en son sein, mais repose plutôt sur les intérêts qui le soutiennent. Comme je l’ai précédemment mentionné, la critique de l’universalisme découle de la critique de l’impossibilité d’une théorie générale. Le travail de traduction présuppose plutôt ce que j’appelle l’universalisme négatif, l’idée la plus communément partagée de l’impossibilité de la complétude culturelle.
Traduction des pratiques
Le deuxième type de travail de traduction s’opère dans le champ des pratiques sociales et de leurs agents. Toute pratique sociale implique un savoir, et en ce sens, nous parlons de pratiques qui sont des « savoir-faire » (knowledge practices). Toutefois, lorsqu’il s’agit de traduire des pratiques, le travail de traduction met spécifiquement l’accent sur l’intelligibilité mutuelle entre formes d’organisation et objectifs, styles d’action et types de lutte. La distinction entre les deux types de travail de traduction dépend après tout du point de vue ou de la perspective qu’on adopte. La spécificité du travail de traduction relatif aux pratiques et aux acteurs se comprend mieux dans des situations où les savoirs qui renseignent les différentes pratiques sont moins faciles à distinguer que les pratiques elles-mêmes. Cela arrive plus particulièrement quand les pratiques ont lieu dans un même univers culturel. C’est le cas par exemple d’un travail de traduction entre formes d’organisation et objectifs d’action de deux mouvements sociaux, comme le mouvement féministe et le mouvement ouvrier dans la société occidentale.
La pertinence d’un travail de traduction concernant les pratiques s’explique de deux façons. D’un côté, les rencontres du FSM ont considérablement élargi le répertoire des luttes sociales disponibles et possibles contre le capitalisme et la globalisation néolibérale. De l’autre, puisqu’il n’existe pas un principe unique de transformation sociale, comme le stipule la Charte des Principes [4][4]http://tinyurl.com/chartePOA, il n’est pas possible de déterminer abstraitement les articulations et les hiérarchies au sein des différentes luttes sociales et des conceptions de la transformation sociale qui sont les leurs, qu’elles concernent les objectifs à viser ou les moyens à employer pour y arriver. Ce n’est qu’en construisant concrètement des zones de contact où se rejoignent des luttes concrètes qu’il est possible de les évaluer et d’identifier les alliances pratiques où elles pourraient s’associer.
Le savoir et l’apprentissage réciproques sont une des conditions nécessaires pour convenir des modalités d’articulation et de construction des alliances. Le potentiel contre-hégémonique de tout mouvement social réside dans sa capacité à s’articuler avec d’autres mouvements, leurs formes d’organisations et leurs objectifs. Pour rendre possible ces articulations, les mouvements doivent se comprendre mutuellement.
Le travail de traduction vise à clarifier ce qui unit et ce qui sépare les différents mouvements et leurs pratiques afin d’établir les possibilités et les limites d’articulation et d’agrégation entre eux. Parce qu’il n’existe pas de pratique sociale universelle ou de sujet collectif uniques qui confèrent un sens et une direction à l’histoire, le travail de traduction devient crucial pour définir, dans chaque contexte concret et pour chaque moment historique, quelle constellation de pratiques subalternes va générer le plus fort potentiel contre-hégémonique.
Le FSM, en montrant la diversité des luttes sociales contre la globalisation néolibérale partout dans le monde, exige un énorme travail de traduction. D’un côté, les organisations et les mouvements locaux ne diffèrent pas seulement en termes de pratiques ou d’objectifs, elles font aussi partie d’environnements culturels différents. De l’autre, les organisations transnationales, qu’elles viennent du Sud ou du Nord, sont très différentes les unes des autres. Comment construire des processus d’articulation, d’agrégation et de coalition entre tous ces mouvements et ces organisations ? Qu’est-ce qu’ont en commun la pratique du budget participatif adoptée dans de nombreuses villes d’Amérique latine et la planification démocratique et participative qui s’appuie sur les panchayats dans les États indiens du Kerala et du Bengale-Occidental ? Que peuvent-elles apprendre l’une de l’autre ? Au sein de quelles activités contre-hégémoniques mondiales peuvent-elles coopérer ? Les mêmes questions peuvent se poser pour les mouvements pacifiste, anarchiste, indigène et gay, le mouvement zapatiste, Attac, les sans-terres du Brésil ou le mouvement « Sauvons la rivière Narmada » en Inde, etc. Ce sont les questions auxquelles le travail de traduction cherche à répondre. C’est un travail complexe, non seulement parce que ces organisations et ces mouvements sont nombreux et divers, mais surtout parce qu’ils font partie d’environnements culturels et cognitifs divers.
Conditions et procédures de traduction
Le travail de traduction se fixe comme objectif de créer de l’intelligibilité, de la cohérence et de l’articulation dans un monde qui se voit considérablement enrichi par la multiplicité et la diversité. La traduction n’est pas une simple technique. Même ses composants purement techniques et la façon dont ils sont utilisés au cours du processus de traduction doivent être l’objet de délibération démocratique. La traduction est un travail dialogique et politique. Elle comporte aussi une dimension émotionnelle, parce qu’elle présuppose à la fois une attitude non conformiste à l’égard des limites de son propre savoir et de ses pratiques et un désir d’apprendre et d’être surpris par les savoirs et les pratiques des autres.
Le travail de traduction part du principe qu’en raison des spécificités culturelles, sociales et politiques de notre époque, il est possible d’arriver à un large consensus autour de l’idée qu’il n’existe pas de théorie générale et globale sur la transformation sociale. Sans ce consensus – le seul genre d’universalisme (négatif) légitime – la traduction est un travail de type colonial, même lorsqu’elle se revendique postcoloniale. Une fois que ce postulat est assuré, les conditions et les procédures du travail de traduction peuvent être élucidées en partant des questions suivantes ? Que traduire ? D’où et vers quoi traduit-on ? Qui traduit ? Quand la traduction doit-elle avoir lieu ? Pourquoi traduit-on ? Explorons un peu la première question.
Que traduire ?
Le concept crucial pour répondre à cette question est celui de zone de contact. Construire des coalitions pour intensifier la mondialisation contre-hégémonique présuppose qu’il existe des zones de contact pensées comme des champs sociaux où se rencontrent et interagissent différents mouvements et organisations pour évaluer mutuellement leurs aspirations normatives, leurs pratiques et leurs savoirs. Au regard de l’histoire de la politique progressiste au XXe siècle, il est probablement inévitable que, lors des premières étapes de construction de ces zones de contact, les relations de pouvoir soient inégales. Le travail de traduction ne sera alors possible que dans la mesure où ces relations inégales de pouvoir s’infléchiront en relations d’autorité partagée. Ce n’est qu’alors que la zone de contact cosmopolitique sera constituée. La zone de contact cosmopolitique part de l’hypothèse qu’il appartient à chaque savoir et à chaque pratique de décider de ce qui va être mis en contact et avec qui. Les zones de contact sont toujours sélectives parce que les savoirs et les pratiques des ONG et des mouvements excèdent en large part ce qu’ils désirent mettre en contact. En effet, ce qui est mis en contact n’est pas nécessairement ce qui est le plus pertinent ou le plus central. Au fur et à mesure qu’avance le travail de traduction, il devient possible pour les ONG et les mouvements d’apporter dans la zone de contact les éléments de savoir ou de pratique qu’ils estiment les plus centraux et pertinents.
Dans les zones de contact multiculturelles, il appartient à chaque groupe culturel de décider quels aspects de la culture vont être sélectionnés pour participer au jeu de la confrontation multiculturelle. Car dans chaque culture, il est des éléments jugés bien trop centraux pour être exposés et rendus vulnérables par une confrontation dans la zone de contact, ou encore des éléments considérés intrinsèquement intraduisibles dans une autre culture. Ces décisions font partie du travail de traduction lui-même et sont susceptibles de révision pendant qu’il se poursuit. Si le travail de traduction progresse, il est à prévoir que de plus en plus d’éléments seront apportés dans la zone de contact, ce qui en retour contribuera à faire avancer le travail de traduction. Dans de nombreux pays d’Amérique latine, plus particulièrement dans ceux où une Constitution multiculturelle a été adoptée, les peuples indigènes se sont battus pour obtenir le droit de contrôler ce qui dans leurs savoirs et leurs pratiques devait ou ne devait pas faire l’objet d’une traduction vis-à-vis de la sociedad mayor [5][5]En castillan dans le texte.. Une fois engagés dans le processus du FSM, les mouvements indigènes ont eu la même démarche à l’égard de l’ensemble des mouvements non-indigènes.
La question de savoir ce qui est traduisible ou pas ne se restreint pas au critère de sélection adopté par chaque groupe dans la zone de contact. Par-delà la sélectivité active, il existe aussi ce qu’on pourrait appeler la sélectivité passive. Elle est ce qui, dans chaque culture, est devenu imprononçable du fait de l’extrême oppression subie pendant de longues périodes. Il est des absences profondes, faites d’un vide impossible à combler ; les silences qu’elles produisent sont bien trop insondables pour devenir ensuite l’objet du travail de traduction.
La question de savoir que traduire en soulève une autre particulièrement importante dans les zones de contact entre groupes provenant d’univers culturels différents. Les cultures ne sont monolithiques que pour ceux qui les regardent du dehors ou de loin. Lorsqu’on les regarde de l’intérieur ou de près, il est facile de voir qu’elles sont composées de plusieurs versions, souvent contradictoires, de la même culture. Par exemple, quand je parle comme je l’ai fait plus haut d’un possible dialogue multiculturel à propos des différentes conceptions de la dignité humaine, nous voyons aisément qu’il n’existe pas qu’une version des droits de l’Homme dans la culture occidentale. On peut au moins en identifier deux : une conception libérale qui privilégie les droits politiques et civiques sur les droits économiques et sociaux, et une conception radicale ou socialiste qui fait valoir que les droits économiques et sociaux sont une condition à tous les autres. Par la même occasion, il est possible d’identifier dans l’Islam plusieurs conceptions de l’umma : certaines, très inclusives, remontent au temps où le Prophète vivait à La Mecque ; d’autres, moins inclusives, ont évolué après la construction de l’État islamique de Médine. Pareillement, l’Hindouisme compte de nombreuses conceptions du dharma, qui varient, par exemple, d’une caste à l’autre. Les versions les plus inclusives, qui comprennent un cercle très vaste de réciprocité, sont celles qui constituent les plus prometteuses zones de contact ; elles sont les plus adaptées pour approfondir le travail de traduction.
Conclusion
Le travail de traduction permet aux mouvements sociaux et aux organisations de développer une raison cosmopolitique reposant sur l’idée centrale que la justice sociale mondiale n’est pas possible sans une justice cognitive mondiale.
Le travail de traduction est la procédure qui nous reste pour créer de la cohérence et mettre en place des coalitions dans un contexte de diversité des luttes contre la globalisation néolibérale, sans avoir recours à une théorie générale de la transformation sociale progressiste (et nous n’en voudrions pas si elle existait) énoncée par l’acteur historique privilégié selon des stratégies et des pratiques centralement décidées. Comme la transformation sociale n’a pas un sens automatique et que ni l’histoire, ni la société, ne peuvent être centralement planifiées, les mouvements doivent, grâce à la traduction, créer des bouts de sens collectif qui les autorisent à se regrouper autour d’actions qu’ils peuvent considérer les plus appropriées pour provoquer le genre de transformation sociale qu’ils estiment le plus désirable.
Nous pouvons nous demander : si nous ne savons pas si un autre monde est possible, qu’est-ce qui légitime ou motive notre façon d’agir comme nous l’avons fait ? Le travail de traduction est un travail d’imagination épistémologique et démocratique qui vise à bâtir de nouvelles conceptions plurielles de l’émancipation sociale sur les ruines de l’émancipation sociale automatique du projet moderne. Il n’existe aucune garantie qu’un meilleur monde soit possible, ni que tous ceux qui n’ont pas renoncé à se battre pour qu’il le soit l’imaginent de la même façon. L’objectif du travail de traduction est de nourrir au sein des mouvements sociaux et des organisations la volonté de créer ensemble des savoirs et des pratiques suffisamment fortes pour fournir des alternatives crédibles à la globalisation néolibérale, qui ne représente ni plus ni moins qu’un pas de plus du capitalisme mondialisé vers la soumission de l’inépuisable richesse du monde à la logique mercantile.
La possibilité d’un monde meilleur est imaginée dans la zone de contact cosmopolitique depuis la position avantageuse du présent. Une fois le champ d’expériences élargi, il devient plus facile de mieux évaluer les alternatives possibles et disponibles aujourd’hui. La diversification des expériences a pour but de recréer la tension entre expériences et attentes, mais de telle manière à ce que les unes et les autres aient lieu dans le présent. La nouvelle non-conformité provient de la vérification qu’il serait possible de vivre dans un monde meilleur aujourd’hui et non demain. Selon moi, la plus profonde contribution du FSM aux luttes contre-hégémoniques est d’affirmer la crédibilité et la durabilité de cette possibilité.
Le travail de traduction permet de créer des significations et des directions qui sont précaires mais concrètes, à court terme mais radicales dans leurs objectifs, incertaines mais partagées. Le but de la traduction entre savoirs est de créer une justice cognitive du point de vue de l’imagination épistémologique. Le but de la traduction entre pratiques et acteurs est de créer les conditions d’émergence d’une justice sociale mondiale du point de vue de l’imagination démocratique.
Le travail de traduction crée les conditions qui permettent des émancipations sociales concrètes de groupes sociaux concrets dans un présent dont l’injustice est légitimée par le gaspillage massif d’expériences. Le genre de transformation sociale qu’il est possible d’accomplir grâce au travail de traduction nécessite un apprentissage réciproque et que la volonté d’articulation et de coalition soient transformées en pratiques transformatrices.
Notes
- [*]Article traduit de l’anglais par Morgane Iserte. Paru sous le titre “The Empathic Civilization. The Race to Global Consciousness in a World in Crisis”. Avec l’autorisation de l’auteur.
- [1]Définition : Terme utilisé en sociologie pour exprimer une réalité intermédiaire entre l’acteur et la structure, réalité qui contribue à faire exister une dynamique collective. « L’agency circonscrirait des agents qui puisent dans leur passé pour y trouver une interprétation commune guidant leur action et des moyens leur permettant d’atteindre des objectifs partagés. » F. Gresle, M. Panoff, M. Perrin, P. Tripier, Dictionnaire des sciences humaines/Anthropologie/Sociologie, Nathan Université, Paris, 1994.
- [2]J’analyse plus en détail les relations entre droits de l’Homme et autres conceptions de la dignité humaine dans B. de Sousa Santos, Toward a New Legal Common Sense, Butterworths, London, 2002.
- [3]Gandhi, The Empathic Civilization: The Race to Global Consciousness in a World in Crisis, 1941.
- [4]http://tinyurl.com/chartePOA
- [5]En castillan dans le texte.